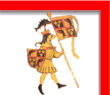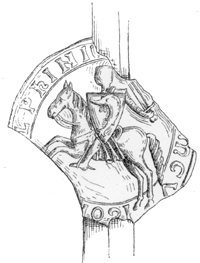|
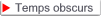

 les comtes d'Albon
les comtes d'Albon
> Guigues
Ier
> Guigues
II
> Guigues
III
> Guigues
IV
- le
nom Dauphin
> Guigues
V
> Beatrix
d'Albon
 la Maison de
la Maison de
Bourgogne
> André
Dauphin
> Guigues
VII
> Jean
Ier
 la Maison de
la Maison de
La Tour
> Humbert
Ier
- les
chevauchées
> Jean
II
-
Mont-Briton
> Guigues
VIII
- sa mort
> Humbert
II
 le Dauphiné Royal
le Dauphiné Royal
> Charles
Ier
> les
gouverneurs
> la
guerre
> Louis
II
 vie quotidienne
vie quotidienne
> agriculture
> industrie
> commerce



|
 |
| Note: Cette page a été complétée le
28/03/2009 Le fils d'André Dauphin poursuit la politique de son père en contractant un
mariage fructueux d'un point de vue territorial en 1241 avec la fille du comte de
Savoie, Béatrice. Un an plus tôt, le Dauphin avait offert en gage les
châteaux d'Avalon et de
La Buissière à sa fiancée. Elle lui apportera en dot le Faucigny. Ce fief
regroupait les territoires environnant Bonneville dans l'actuelle Haute
Savoie, soit une
zone éloignée du Dauphiné et donc difficile à contrôler, d'autant plus que le comte
de Savoie réalise, mais un peu tard, qu'il est désormais encerclé par son
voisin. La
plupart des guerres delphino-savoyardes à venir auront pour origine cette écharde
plantée dans le pied de la Savoie.
Dans le Grésivaudan, le domaine delphinal s'agrandit
sur la rive gauche en 1247 , quand Pierre et Guigues Eynard
échangent l’ensemble de leurs terres de Gières à Allevard,
en incluant le château de Theys, contre la terre de Savel en
Matheysine. A cette époque, le château de Domène ne leur
appartient déjà plus et avait été cédé aux comtes de Genève.
Le mandement d'Allevard, qui était la
possession des seigneurs de La Rochette, est acquis en deux temps (1249 et
1263). Le seigneur de Bellecombe,
Aimeric de Briançon rend lui hommage au Dauphin en 1236, faisant ainsi de son mandement le
poste de défense avancé sur la rive droite de l'Isère et renvoyant La Buissière en
seconde ligne. Au sein même de son territoire, Guigues parvient à contraindre des
seigneurs indépendants à abandonner leurs droits sur leurs mandements, comme à
Sassenage ou Beauvoir en Royans.
|
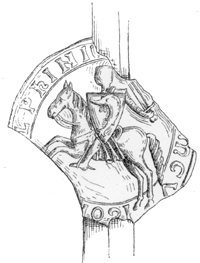
Sceau de Guigues VII - 1237
(première représentation du symbole du dauphin) |
Il confisque même la châtellenie de
Morêtel de Mailles
en 1251, son seigneur ayant refusé de lui prêter hommage. Sur la rive droite
en amont de Montbonnot, le domaine delphinal n'inclut que La
Buissière à cette époque. Pourtant, les territoires situés entre ces
deux mandements (les futures seigneuries de Saint-Ismier, Bernin,
Montfort, La Terrasse et le Touvet) sont contrôlés par Pierre Auruce,
fils du maréchal Obert Auruce qui avait été le régent du Dauphiné
pendant la minorité de Guigues VII. Le dauphin parviendra à se
débarrasser de son encombrant tuteur à l'issue de quinze ans de
lutte en 1258. La liberté laissée à son fils pour développer la rive
droite de l'Isère semble être une compensation. De 1260 à 1282,
Pierre Auruce, qui est également châtelain de Montbonnot, va ainsi
réaliser plus de cent acquisitions de terres dans la vallée, pour
devenir rapidement le noble le plus riche du Grésivaudan, après le
dauphin.
Il est clair à partir du XIIIe siècle que les seigneurs locaux n'ont plus les moyens de s'opposer aux volontés
expansionnistes des puissants Dauphins. La puissance de Guigues VII
n'est pourtant que toute relative: près de la moitié de ses revenus
proviennent des seigneuries des vallées alpestres et de l'Oisans
alors que le riche Grésivaudan (étendu à la cluse de Voreppe,
Grenoble et Vizille) ne concourt qu'à hauteur de 17%, ce qui est
très peu.
Les chartes de franchise se multiplient (Goncelin
et Allevard en 1255, Avalon en 1265).
Pourtant, la guerre larvée dans ces années 1260 avec la Savoie
oblige à renforcer la défense des châteaux de la vallée. Guigues VII meurt en décembre 1269. Suite... |