| Le comte de Savoie juge en 1339 que
sa frontière en avant des Marches est insuffisamment protégée et
décide de reconstruire un château à l’emplacement d'une première
bâtie détruite en 1303 dans la prairie des Mortes. Mais cette
fois, une partie de la construction est en maçonnerie. Des
difficultés surviennent immédiatement entre le Dauphin et le
comte de Savoie au sujet de ce petit château. Le 21 avril 1339,
le Dauphin ordonne à Amblard de Briord, bailli du Grésivaudan de
débuter la construction de la Bâtie de Belle-Marche dans la
plaine entre Chapareillan et Les Marches, près du ruisseau du
Glandon, à portée de flêches de la première. Le 3 juin, Henri
Gras, châtelain delphinal de Bellecombe, proteste contre la
construction entreprise par le comte de Savoie et fait procéder
à l’aide d’une catapulte à un triple jet de pierres devant les
officiers et ouvriers savoyards . Dès le lendemain, le procureur
delphinal en Grésivaudan protesta devant le conseil du comte de
Savoie à Chambéry contre la construction de la maison forte mais
sa requête resta lettre morte . En juin 1339, Humbert II
convoque une armée venant des baronnies de Montauban et
Mévouillon pour une durée d’un mois et destinée à attaquer la
bâtie des Mortes, mais la cavalcade se termina sans combat .
Signe de la gravité de la situation, on fait appel à l’arbitrage
du Pape. Malgré une décision en faveur du Dauphin, le comte de
Savoie refuse d'abandonner sa bâtie.
Le sort des deux bâties se décidera quinze ans plus tard, en
avril 1354. De retour de la bataille des Abrets, le comte Amédée
VI (dit le Comte Vert) vient mettre le siège devant la bâtie de
Belle-Marche. Le Dauphin lui fait dire par un héraut que sous
trois jours il arriverait avec son armée. Le comte lui fait
répondre que la bâtie sera prise d'ici le lendemain soir et
qu'il attendra le Dauphin quatre à cinq jours. Pour faciliter le
franchissement du ruisseau du Glandon, deux charpentiers
savoyards utilisent six chevrons pour relier les deux bâties
adverses par un pont. Puis un autre pont est édifié pour
franchir le fossé de la bâtie de Belle-Marche. Avec quatre chevrons, ils font des bras munis de crocs de fer pour arracher les pieux
et les palissades du Dauphin. Le lendemain, le château est pris.
Le comte investit un châtelain avec une garnison d'arbalétriers
et de clients, puis va installer son camp près de Chapareillan.
Le Dauphin n'étant jamais venu, il fait abattre dans un accès de
colère les deux bâties de Belle Marche et des Mortes, pour «signifier
qu’il n’est force que d’hommes et que où il y a gents de coeur
il n’est besoin de bastides ou fortifications » .
Le localisation de la bâtie de Belle-Marche n’est pas aisée
de nos jours. Il existe un lieu-dit « la bâtie » près du
ruisseau du Glandon. La bâtie pourrait correspondre à une levée
de terre située à gauche d’un chemin partant de la D285c, à
proximité d’un vieux pont portant une borne sarde. La bâtie des
Mortes devait être « à portée de flêches », soit à environ 150
mètres de l’autre côté du pont, dans un bois qui porte encore
des traces de fossés au lieu-dit « Les Eaux Mortes ».
 |
Cliquez sur les vignettes pour les voir en plein écran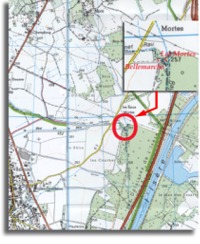

L'emplacement des bâties (vue prise depuis Bellecombe)

Au delà du pont du Glandon en direction de l'ouest, emplacement
présumé de la bâtie dauphinoise de Belle Marche (dans le taillis
sur une petite élévation)

Au delà du pont du Glandon en direction de l'est, emplacement
présumé de la bâtie savoyarde des Mortes (marquée par un remblai
protégé par des fossés) |